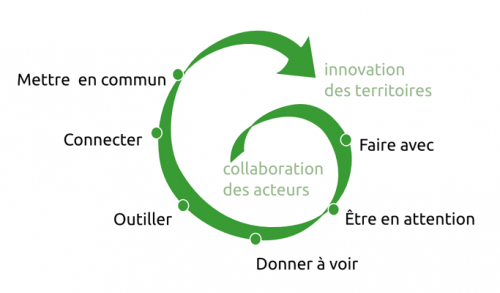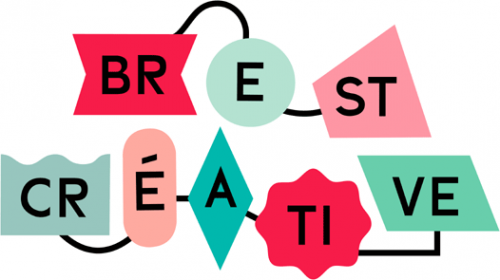[billet initialement publié sur le blog Papiers et Poussières, par Jordi Navarro]
[billet initialement publié sur le blog Papiers et Poussières, par Jordi Navarro]
Dès son arrivée au ministère de la culture, Aurélie Filippetti avait promis de revoir en profondeur le code du patrimoine. Elle en avait fait son cheval de bataille. Les reports successifs et le récent remaniement ont bien failli la priver de voir l’aboutissement de ce projet. Finalement maintenue dans ses fonctions, il y aura bien une « loi Filippetti sur le patrimoine ».
J’avais personnellement espéré beaucoup de choses de cette loi. Il me semblait que c’était l’occasion rêvée de codifier la loi CADA en l’intégrant au livre des archives du code du patrimoine. Le libre accès aux documents administratifs, ainsi que le droit à la libre réutilisation ont toute leur place au sein du chapitre 3 portant sur le régime de communication. Codifier la loi 78-753 aurait de plus été totalement en phase avec la volonté politique actuelle d’ouverture des données publiques.
Le moins que l’on puisse dire est que j’ai été amèrement déçu.
J’ai commencé à craindre le pire dès l’année dernière lorsqu’un texte préparatoire avait circulé dans la profession. Mais il ne s’agissait alors que d’un document de travail susceptible d’être encore modifié.
Mes craintes se sont hélas confirmées plus récemment lors d’une interview d’Hervé Lemoine à la Revue française de généalogie, suivie d’une audition au Sénat sur la réutilisation des informations publiques et, enfin, de la publication du pré-projet et de son étude d’impact.
Le projet consiste, ni plus ni moins, à mettre un terme à la libre communication des archives définitives en les sortant expressément du champ d’application de la loi CADA.
Pour bien comprendre de quoi il retourne, regardons ce qu’il en est actuellement.
La loi 78-753 indique que tout document administratif, dès lors qu’il est communicable, doit être communiqué à toute personne qui en fait la demande, quel que soit le lieu où se trouve le document (administration ou service d’archives), et quel que soit le motif de la demande (administratif, historique ou autre).
Cette communication peut se faire par consultation sur place (gratuitement), par envoi postal d’une reproduction (frais de copie et d’envoi à la charge du demandeur) ou, si cela est possible, par mail (gratuitement). Le choix entre ces trois modes de communication appartient au demandeur, pondéré bien entendu par les possibilités du service et l’état du document.
Cette obligation de communication et le choix laissé au demandeur montrent très clairement la force que le législateur a voulu donner à ce principe. En matière d’accès aux documents administratifs, c’est à l’administration de tout mettre en œuvre pour satisfaire la demande de l’usager.
Cette obligation de transparence de la vie publique répond à un triple objectif. Il s’agit de permettre au citoyen de faire valoir ses droits, de lui assurer la possibilité de contrôler le fonctionnement de l’administration et de lui garantir l’accès à la mémoire collective.
Le principe de libre communicabilité est intimement lié à l’exercice de la démocratie.
Et voilà donc ce que cet avant-projet de loi entend remettre en question. Car voici ce que dit la nouvelle version de l’article L213-1 :
Les archives publiques sont […] communicables de plein droit et sans délai.
L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-753 [...] jusqu’à leur transfert dans les services publics d’archives compétents.
Après transfert dans ces services, l’accès aux archives s’exerce par consultation gratuite sur place.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’accès aux archives continue de s’exercer dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitée quand il est motivé par les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques et des personnes morales.
Les services publics d’archives peuvent également déterminer d’autres modalités d’accès aux archives.
Pour résumer, dès lors que les documents seront dans un service d’archives, ils ne seront plus librement communicables. À moins d’en avoir besoin pour des raisons administratives, il ne sera plus question pour l’usager d’exiger la communication à distance d’un document. La consultation sur place sera l’unique garantie apportée par la loi, charge aux services d’archives d’être plus généreux s’ils le souhaitent.
Pour la première fois, les documents seront moins accessibles dans les services d’archives que dans les administrations. Un comble.
Pourquoi un tel choix ? Pourquoi revenir sur ce principe démocratique ?
La justification en est donnée dans l’étude d’impact. Ou plutôt les justifications, puisque deux arguments sont avancés :
les modalités d’accès aux archives […] fragilisent les données à caractère personnel et alourdissent excessivement la charge de travail des services publics d’archives
Penchons-nous sur ces deux arguments.
Les données personnelles sont régulièrement utilisées depuis 2010 pour justifier des refus de réutilisation.
Rappelons tout d’abord que les délais de communicabilité prévus par le code du patrimoine sont justement là pour protéger l’accès aux données personnelles. Si ces délais sont jugés trop courts, la meilleure solution aurait sans doute été de les augmenter. Le pré-projet fait pourtant exactement l’inverse en proposant, par exemple, de diminuer le délai d’accès aux actes de mariage (passant de 75 à 50 ans). Comment peut-on, d’un côté, dire que le libre accès représente un risque pour les données personnelles et, d’un autre, diminuer les délais d’accès à ces mêmes données ? Schizophrénie ou hypocrisie ? Je vous en laisse juge.
Par ailleurs, pour les données personnelles communicables, la CADA, la Cnil et le juge administratif ont clarifié la question en expliquant très clairement ce qu’il est possible de faire ou non avec des données personnelles. Ces trois instances ont toutes les trois réaffirmé qu’une fois les fameux délais échus, les données personnelles sont librement communicables et qu’elles sont également réutilisables. Elles ont toutes les trois rappelé que la protection des données personnelles relève de la compétence de la Cnil. Elle seule est en mesure de dire ce qu’il est possible ou non de faire avec des données personnelles, ce qu’elle n’a pas manqué de faire. Le juge avait déjà affirmé que les archivistes n’avaient pas à se substituer à cette autorité. Dès lors qu’elle a autorisé un usage, cette autorisation s’impose à tous.
Et si un usager venait à ne pas respecter les dispositions de la Cnil, c’est à cette dernière qu’il devrait rendre compte puisque, rappelons-le, elle dispose de son propre pouvoir de sanction.
Rappelons enfin un point essentiel : la diversité des archives. Tous les documents administratifs ne comportent pas de données personnelles. Pourquoi donc limiter également l’accès à ceux qui n’en contiennent pas ?
Cet argument de protection des données personnelles ne tient pas la route.
Examinons maintenant le second argument, celui de la charge de travail.
L’idée est la suivante : initialement, les demandes d’accès aux documents administratifs sont gérées par les services qui produisent ces documents. La charge de travail est donc répartie au sein des différentes administrations. Mais dès que les documents ont été versés à un service d’archives, celui-ci devient le seul à gérer l’ensemble des demandes. La charge de travail se reporte donc sur un seul et unique service, ce qui poserait problème.
À titre d’illustration, l’étude d’impact indique que des usagers auraient très bien pu demander la copie de l’ensemble des 3600 kilomètres de documents conservés dans les services d’archives. Cet argument est d’une telle mauvaise foi que je ne vais pas m’y attarder outre mesure. Le fait est qu’une telle demande est tout simplement irréaliste.
Mais passons outre cette maladresse d’argumentation. La charge de travail est un point qui ne peut pas être éludé d’un simple revers de main. Regardons ce qu’il est en est.
Les statistiques publiées chaque année par le SIAF sont là pour nous aider. Si l’on regarde les chiffres des Archives départementales, on s’aperçoit qu’en 2012 chaque service a dû traiter en moyenne 1211 demandes par correspondance. Soit près de 5 demandes par jour ouvré. De plus, depuis 2010, le nombre de ces demandes a augmenté de près de 53 %. Le fait est que ce n’est pas négligeable.
La foule | jfgornet | CC by-sa
De quoi justifier de freiner les ardeurs des usagers ? Pas si sûr.
Revenons tout d’abord aux termes de la loi 78-753 qui encadre l’exercice du droit d’accès. Tout d’abord, l’article 4 indique très clairement que les possibilités d’accès sont limitées par les possibilités techniques de l’administration. Autrement dit, si le nombre de demandes est tel que le service d’archives n’est pas en mesure de les traiter, ou que cela ne permet plus de mener à bien les autres missions, un service a la possibilité de limiter le libre accès.
Par ailleurs, l‘article 2 de cette même loi précise bien que l’administration n’est pas tenue de faire droit « aux demandes abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ».
Les services d’archives disposent donc déjà de deux leviers par lesquels il est possible de limiter le droit d’accès. Bien entendu, en cas de saisine de la CADA ou du tribunal administratif, l’administration doit être en mesure de prouver la réalité de ce qu’elle avance. Peut-être est-ce précisément ce qu’elle cherche à éviter.
Car la réalité des demandes par correspondance n’est pas celle que l’étude d’impact veut faire passer.
Les chiffres du SIAF ne sont pas suffisamment détaillés pour s’en convaincre. Je ne peux donc que m’appuyer sur mon expérience personnelle. Tous les services ont connu la même explosion du nombre de demandes par correspondance.
Mais cette augmentation est due en exclusivité à celle des demandes à caractère administratif, elle-même due exclusivement au versement des documents de la conservation des hypothèques.
Il y a bien eu transfert de la demande des usagers, mais uniquement en ce qui concerne les demandes administratives pour lesquelles il n’est pas prévu de limiter l’accès et qui représentent actuellement l’écrasante majorité des demandes.
Dans le même temps, le nombre de demandes à caractère généalogique ou historique s’est effondré, pour une raison très simple : nous numérisons et mettons en ligne un nombre de plus en plus important de documents. Les usagers n’ont plus besoin de nous demander des copies puisque nous les leur mettons à disposition.
La vérité est donc là. Nous, archivistes publics, sommes de plus en plus sollicités pour des demandes de communication à but administratif et juridique. Le meilleur moyen de diminuer les autres catégories de demandes n’est certainement pas de les refuser, mais plutôt de numériser les documents concernés et de les mettre en ligne. Une seule conclusion s’impose. Si les archivistes ne souhaitent plus traiter des demandes non administratives, il leur faut améliorer les conditions d’accès aux documents et non l’inverse. Notons au passage, encore une fois, que l’ouverture est bien vectrice de simplification administrative.
Récapitulons. Le projet de loi propose de restreindre le droit d’accès aux documents administratifs détenus par les services d’archives. Mais aucun des deux arguments avancés pour justifier cette restriction n’est valable.
Dans ce cas, quelle est la justification réelle de ce retour en arrière ? Elle est en fait très simple. L’objectif poursuivi est de permettre aux services d’archives de s’opposer à la réutilisation des informations publiques qu’ils détiennent sans avoir à se justifier. Nombre d’entre eux avaient tenté de le faire, avant que le juge ne les rappelle à la loi. La solution est donc toute trouvée : « puisque la loi ne nous convient pas, changeons la loi ».
Le fait de ne plus garantir le libre accès aux archives entraîne de facto l’impossibilité de garantir la libre réutilisation. Pas d’open data sans libre accès.
Mais faut-il rappeler que l’ouverture des données publiques est un enjeu de démocratie ? Faut-il rappeler qu’il s’agit là d’une demande exprimée par toutes les composantes de la société (citoyens, associations, entreprises, politiques) ? Faut-il rappeler enfin que la mission première des archivistes est de rendre l’information accessible ?
En cherchant à empêcher la réutilisation, les archivistes contreviennent à chacun de ces trois points. Ils reviennent sur un principe démocratique, s’opposent à une demande sociétale et renient l’essence même de leur métier.
Prison | kIM DARam | CC by-nc
Par ailleurs, j’ai du mal à saisir la logique du législateur qui fait preuve d’une grande schizophrénie en retirant les archives du cadre de la loi Cada alors qu’en parallèle, il s’apprête à imposer l’open data aux collectivités.
Que dire également du ministère de la Culture, porteur de ce projet de loi, et qui a pourtant publié un rapport prônant « l’ouverture et le partage des données publiques culturelles » ?
Malgré des initiatives locales, les archives restent décidément le mouton noir de l’open data.