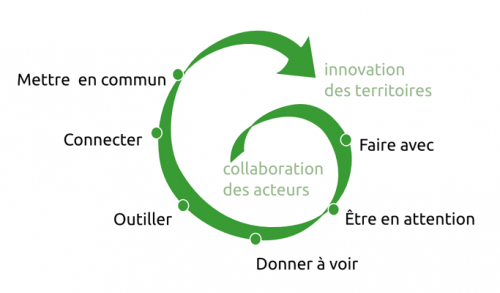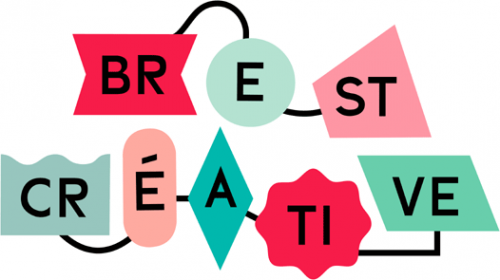Lors du dernier congrès ADBU (Association des Directeurs et personnels de direction des Bibliothèques Universitaires et de la Documentation), l’avocat Alain Bensoussan, spécialisé en droit du numérique et président du réseau international d’avocats Lexing, est venu plaider dans une allocution intitulée « Droit des plateformes et open science », pour la fondation d’un “droit de la science ouverte”. Le CNRS, l’ADBU et le réseau Lexing soutiennent le projet de rédaction d’une “charte universelle de l’open science”. Ce “droit de l’open science” aurait pour visée d’assurer “un libre partage et une libre réutilisation” des données de la recherche. Le scénario d’une simple exception au droit d’auteur n’est pas retenu, dans la mesure où une exception ne ferait que confirmer la règle, à savoir le maintien des résultats de la recherche sous l’emprise du paradigme propriétaire. Il s’agit de fonder un droit de l’open science en écrivant “une charte, puis une loi, puis une convention mondiale”.
Le collectif SavoirsCom1 tient à manifester son soutien à ce projet. Les résultats de la recherche scientifique sont actuellement en grande partie captés par les éditeurs scientifiques. Le droit sui generis des bases de données, issu de la directive communautaire du 11 mars 1996 transposée par la loi du 1er juillet 1998 permet aux éditeurs de revendiquer un droit sur la réutilisation du contenu des bases de données dont ils sont les producteurs. C’est ainsi que l’éditeur Elsevier a voulu imposer récemment au consortium Couperin l’acceptation d’une clause obligeant les chercheurs à recourir exclusivement à l’API mise à disposition par l’éditeur pour la fouille de données (Text and Data Mining, TDM). C’est ainsi qu’un éditeur comme Springer n’autorise la fouille de données que si le chercheur détaille préalablement son projet. Plus globalement, c’est en tant que producteurs de bases de données que les éditeurs revendiquent le droit de facturer à des coûts souvent prohibitifs l’accès aux articles pourtant issus de la recherche financée sur fonds publics.
La propriété industrielle est susceptible de constituer un second frein à l’open science. Les brevets confèrent au déposant un monopole d’exploitation durant 20 ans. Les Certifications d’Obtentions Végétale protègent les inventions durant 25 voire 30 ans. Ce sont autant d’années pendant lesquelles les fruits de la recherche publique sont rendus inaccessibles aux citoyens.
Il existe enfin un troisième obstacle au déploiement d’une science véritablement ouverte. La loi DADVSI de 2006 confère aux chercheurs une pleine titularité sur leurs travaux. Contrairement aux autres « agents publics », le chercheur jouit « d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » sur ses travaux (art. 111-1 du CPI). Autrement dit, cette loi, qui transpose en droit français la directive européenne 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, fait dépendre la réutilisation des résultats de la recherche du bon vouloir de chacun des chercheurs. Lesquels se retrouvent donc à tenter de négocier directement leurs droits avec les éditeurs, dans une situation forcément déséquilibrée. Les éditeurs sont en position de force pour imposer leurs moindres desiderata : durée de l’embargo, conditions de réutilisation, coût de l’accès aux revues pourtant entièrement composées d’articles issus de la recherche publique, etc. C’est justement parce que cette situation qui lie le partage des données de la recherche au choix de chaque chercheur n’est plus viable, que les nouvelles politiques publiques d’Open Access visent à passer outre les contrats négociés individuellement et à imposer des règles nationales uniformes ou du moins à aménager des marges d’autonomie pour les chercheurs : loi américaine de janvier 2014 imposant aux organismes fédéraux dont les budgets de recherche sont supérieurs à 100 millions de dollars par an de fournir au public un accès en ligne gratuit aux articles scientifiques générés par des fonds fédéraux au plus tard 12 mois après la publication dans une revue à comité de lecture, dispositif européen Horizon 2020 (2014-2020) qui prévoit le dépôt obligatoire pour la recherche financée par des fonds européens, loi allemande du 13 octobre 2013 qui permet le dépôt dans une archive ouverte, après un embargo de 12 mois, des résultats issus de la recherche financée au moins pour moitié par des ressources publiques, loi britannique entrée en vigueur le 1er juin 2014 qui consacre le droit au Text and Data Mining, du moment que l’institution à laquelle est rattaché le chercheur est abonnée à la ressource qui fait l’objet de la fouille et que la recherche poursuit un but non commercial , etc
Ce sont ces trois logiques cumulées, d’abord juridiques avant que d’être économiques, qui consacrent le paradigme d’une science propriétaire. Les politiques d’Open Access ont permis d’accroître l’accès libre aux résultats de la recherche. Mais elles ne suffisent pas pour aboutir à une véritable « Science ouverte ». La licence par défaut qui s’applique aux articles déposés dans les archives ouvertes relève en règle générale du droit d’auteur « classique ». Cela signifie qu’aucune réutilisation des articles n’est possible sans l’accord exprès des auteurs. Ce qui se traduit par la mention « tous droits réservés ». Il s’agit d’une ouverture des données en trompe-l’œil : on a beau parler d’archives « ouvertes », la réutilisation des articles est bloquée. Les archives ouvertes ont été conçues pour une « communication scientifique directe », non pour une réutilisation directe, et ce, en dépit du principe d’ouverture des données, maintes fois réaffirmé depuis la déclaration de la « Budapest Open Access Initiative » de 2001. Dans ce cas, l’Open Access ne constitue pas une réelle alternative à la science propriétaire. On ne peut parler d’Open Science que si les articles, données et inventions sont placées sous un régime juridique compatible avec les principes de l’Open Definition.
Pour sortir de cette impasse, il faudrait que le statut des résultats de la recherche ne soit plus régi par les règles de la Propriété Intellectuelle. Les résultats de la recherche ne sont pas des créations originales au sens d’oeuvres de l’esprit mais des faits. Ils constituent le Domaine Public de l’Information. (1)
Sans une véritable consécration du Domaine Public de l’Information, les universités, les grandes écoles, les organismes publics de recherche et les Etats sont condamnés à mettre en oeuvre des solutions alternatives, qui quoi qu’on en dise, ne sont que des solutions insatisfaisantes :
Scénario 1 : les mandats institutionnels
Des universités américaines, comme Harvard ou Princeton, ont mis en place des mandats qui permettent de retenir des droits non exclusifs sur toutes les futures publications de leurs chercheurs. Ce modèle américain est inapplicable en droit français car « la cession globale des oeuvres futures est nulle » (art. 131.1 du CPI). Les universités françaises peuvent donc se rabattre sur une politique de mandat sans transfert de droits, mais en proposant à leurs chercheurs de recourir à l’utilisation d’un avenant type aux contrats d’éditeurs par lequel l’auteur conserve ses droits d’archivage. En France, la portée d’un mandat émis par le Président d’une université, d’une grande école ou d’un organisme public de recherche ne peut de toute façon être que limitée, pour deux raisons au moins : la grande majorité des laboratoires sont multi-tutelles, ce qui ôte au mandat son caractère impératif et systématique ; de plus la capacité à contraindre les chercheurs à déposer est faible, car la gestion de carrière des chercheurs n’est pas gérée directement par la Présidence, mais par la CNU, instance nationale autonome.
Scénario 2 : les licences ad hoc entre les éditeurs et les consortiums ou les États.
Le risque de la généralisation de telles licences est de permettre aux éditeurs de garder la haute main sur les contenus. L’implosion en février 2013 du Text and Data Mining Working Group, le groupe de travail européen qui réfléchissait à une modification du cadre légal du Text and Data Mining, est due à l’attitude des principaux éditeurs scientifiques qui refusaient de faire évoluer le système hors du cadre des licences éditoriales.
Scénario 3 : la consécration par la loi ou une directive d’une exception (exception qui rend le dépôt des articles dans une archive obligatoire, exception de Text and Data Mining, etc.)
Mais, comme le souligne la rapport Hardgreaves dans le cas du TDM : formulée en termes spécifiques pour décrire une technique de fouille de données à un instant t, une exception court le risque de devenir obsolète au moment où la technologie aura évolué. Qui plus est, une exception ne fait que confirmer la règle, en l’occurrence celle d’une science assujettie au paradigme propriétaire. Comme le dit très bien l’avocat Alain Bensoussan : « Reconnaître juridiquement l’open science par un principe d’exception au droit d’auteur signifie qu’en amont, la science est soumise au droit de propriété ». Or la science ne doit pas être la propriété d’untel ou untel. Elle est un Commun universel !
Scénario 3 bis : la consécration d’une « norme ouverte »
Préconisée par le rapport Hardgreaves, l’ « open norm » consisterait à dépasser l’interprétation étroite du « test en trois étapes« , pour aboutir à une liste non fermée d’exceptions. La norme ouverte apporterait plus de flexibilité dans un environnement technologique en mutation rapide. Mais elle aurait aussi un inconvénient : l’appréciation de la légalité d’une réutilisation serait faite ex-post par le juge. L’ »open norm » introduirait donc davantage d’incertitude juridique pour les parties-prenantes.
Scénario 4 : l’intégration des données de la recherche dans une politique Open Data.
Valable surtout pour les données de la recherche, elle consiste à mettre en place une politique d’Open Data instaurant une ouverture par défaut des données produites ou collectées par les établissements de recherche. Avec une volonté politique forte, ce scénario est tout à fait envisageable, mais il se heurte à deux obstacles juridiques. D’une part, la réutilisation des données publiques est neutralisée lorsque les informations sont contenues dans des documents couverts par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers (art. 10 de la loi de juillet 1978 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : (…) c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ».) Or c’est fréquemment le cas dans le secteur de la recherche et les chercheurs sont considérés comme des tiers à l’administration. D’autre part, la nouvelle directive européenne PSI (Public Sector Information) de 2013 sur la réutilisation des données publiques conserve un régime d’exception pour les données de recherche, qui fait que chaque établissement public de recherche restera libre de choisir d’ouvrir ses données ou non. L’ouverture des données de la recherche n’est pas impossible, mais elle risque de rester complexe et tributaire des décisions de chaque établissement de recherche.
Mettre en place une Charte universelle de l’Open Science consistera à lever ces différents obstacles, qu’ils se situent au niveau national, européen ou mondial. Sans minimiser les difficultés, le collectif SavoirsCom1 apporte son soutien à cette démarche et se déclare prêt à contribuer au projet.
***
(1) Le rapport Hardgreaves effleure un peu cette idée lorsqu’il propose parmi les pistes d’action d’opérer une distinction normative stricte entre les actes de reproductions « expressifs » et « non-expressifs ». Il faut entendre par non-expresif, un acte de reproduction dépourvu d’originalité, notamment s’il est produit par une machine. « Le législateur pourrait adopter une démarche normative et ne reconnaître une protection [au nom du droit de reproduction de la Propriété Intellectuelle] que pour les actes de reproduction ou d’extraction qui comportent effectivement un acte d’exploitation expressif ». En faisant sortir les articles et les données de la recherche du régime de la Propriété Intellectuelle, on pourrait opérer une distinction analogue : il ne s’agirait pas de faire le distinguo entre les actes de reproduction mais entre les créations elles-mêmes. Ou bien la création est une oeuvre de l’esprit, c’est -à-dire une « une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficiant d’une mise en forme », ou bien la création ressortit du domaine public. A ce second cas s’ajouteraient « les données, faits, idées, procédures, procédés, systèmes, méthodes d’opération, concepts, principes ou découvertes, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont décrits, expliqués, illustrés ou intégrés à une œuvre, ainsi que les lois et décisions judiciaires. » (Art. 1er de la Proposition de loi Attard visant à consacrer le domaine public, à élargir son périmètre et à garantir son intégrité)