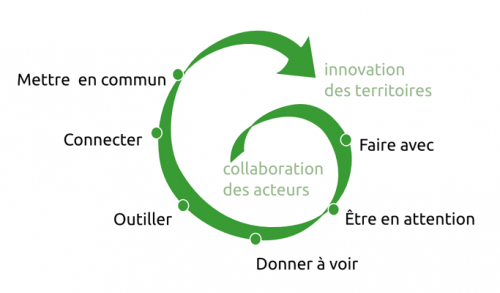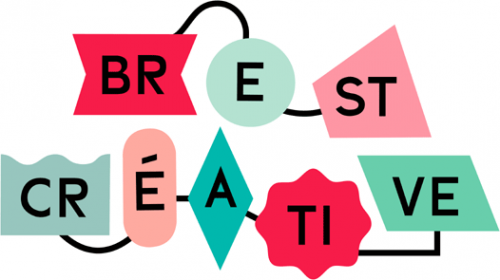Résumé
Au milieu du gué. C’est ainsi que Roger Sue décrit nos sociétés et nos économies, pétrifiées à mi chemin entre le modèle industriel dominé par les services - le « tertiaire » - et le modèle de l’économie cognitive ou immatérielle, qu’il intitule résolument le « quaternaire ». Certes tout le monde – entreprises, pouvoirs publics, institutions internationales – célèbre le rôle des technologies de l’information et des connaissances dans l’économie qui s’en vient. Mais, selon l’auteur, nous ne saisissons pas la radicalité des transformations induites tant dans nos entreprises, dans nos sociabilités que dans nos rapports aux savoirs et aux apprentissages. Ce faisant nous n’en tirons pas les choix politiques susceptibles d’accompagner cette « grande transformation ».
Certes les connaissances sont la clé de voûte de nos économies, mais pas nécessairement les savoirs d’accumulation, ceux que nous empilons laborieusement dans nos cursus scolaires et universitaires. Les connaissances dont nous avons besoin, dans une société que les infrastructures techniques contribuent à rendre réticulaires, informelles et mieux distribuées, sont plutôt de l’ordre du « savoir coopérer », du « savoir créer », de l’imaginaire, de l’intuition, de la reliance aux autres, bref du « savoir-être » tout autant que du savoir-faire. Travailler dès lors consiste tout autant à produire dans la créativité qu’à « se produire », c’est à dire à se construire soi-même, dans son rapport à soi et au monde.
Ceci rend en partie obsolète les indicateurs traditionnels du travail / emploi : rejoignant les analyses de Yann Moulier-Boutang, Roger Sue acte que, comme c’est déjà le cas notamment pour l’artiste ou l’enseignant chercheur aujourd’hui, le temps fera de moins en moins sens. Car ces nouvelles tâches appellent un renouvellement continu du capital cognitif, qui ne se limite plus aux temps formels de l’éducation et de la formation.
L’entreprise n’échappe pas au phénomène : celle-ci prend conscience de l’importance du travail implicite, des qualités et compétences ascendantes des salariés (autonomie, capacité de coopération, de développement personnel...) mais ne sait comment les mobiliser et les reconnaître.
Au delà de l’entreprise, l’emploi devra inéluctablement se recomposer autour d’activités liées à cette valorisation de la personne : santé comme pré réquisit, développement des capacités, valorisation du capital humain. Alors que les besoins non marchands explosent et que l’économie devient de facto de plus en plus « sociale » (cf. les dépenses de santé, de protection sociale, d’éducation, de culture...) dans un contexte de ressources publiques limitées, « l’extension du non-marchand est de plus en plus la condition même de survie du marché ». Plus radicalement c’est la question de la sortie de l’emploi qui est posée : ne devons-nous pas aller jusqu’au bout d’une flexibilité de l’emploi qui gagne chaque jour plus de terrain et la négocier contre un revenu de citoyenneté, allant ainsi vers une économie redistributive (en complément ou substitution des économies domestique, publique et marchande identifiées par Karl Polanyi) ? Selon l’auteur, c’est la seule manière d’éviter une scission de la société en deux : d’un côté les gagnants de la flexibilité, qui y trouvent autonomie et adéquation avec une activité cognitive, de l’autre les grands perdants, ceux que la flexibilité enfonce dans la précarité et la pauvreté.
À ne pas vouloir acter ce glissement des besoins vers de nouvelles connaissances, et à ne pas les intégrer dans une école qui demeure ancrée sur un modèle du savoir universel scientifique, on contribue à accroître les inégalités. Seuls certains milieux sociaux sauront transmettre ces aptitudes aux générations montantes.
Pour autant, les modalités de cette transmission restent à inventer. Une question complexe. Plutôt que d’en rejeter une fois de plus la responsabilité vers l’école, Roger Sue invite à se tourner vers le monde associatif. Il observe que les associations remplissent trois grandes fonctions :
- La reliance : l’association permet de tisser du lien social, sans obérer l’individualisation comme processus de civilisation (à différencier de l’individualisme). Car la participation à une association apporte d’abord une connaissance de soi, une mise à jour de savoirs enfouis, l’ouverture d’un nouvel espace de reconnaissance, celle-là même que l’entreprise ne sait plus accorder. Il s’agit de « s’engager pour soi, s’engager avec les autres » tout en « s’engageant pour les autres, dans son époque ». C’est aussi une manière de faire de la politique au moment même où les structures médiatrices traditionnelles du politique souffrent de désamour de la part des populations.
- Les compétences : alors que l’éducation populaire en France approche le siècle et demi d’existence, le monde associatif porte dans son ADN la question de l’éducation permanente et du croisement des savoirs, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective. Les savoirs développés en son sein relèvent des compétences transverses - échange, engagement, sens pratique, créativité, capacité à l’autoformation...-. En ce sens l’association constitue un incubateur naturel des connaissances nécessaires au « quaternaire », celles-là même que ni l’école ni l’entreprise ne savent encourager. Un constat qui doit amener à la reconnaissance de l’association comme système de formation à part entière, à l’image de ce qui se pratique déjà dans certains pays scandinaves.
- La performance : pour répondre à la part « sociale » croissante de l’économie, les secteurs public et privés seuls sont impuissants. Il est nécessaire d’impliquer tout un chacun, quelles que soient ses qualités (âge, disponibilité, compétences...), dans un rapport de proximité, tout en donnant la priorité à la prévention (de la santé, de l’environnement...). Toutes conditions d’efficacité que le monde associatif sait remplir. Plutôt que d’effectuer un transfert massif vers le secteur privé dont on mesure actuellement l’inefficacité, la construction de partenariats entre entreprises et associations semble plus performants pour répondre à ces enjeux. Des partenariats qui passent notamment par le mécénat de compétences (immersion à temps partiel de salariés dans le monde associatif, financé par l’entreprise), opération gagnant-gagnant pour les deux structures comme pour le salarié. Un modèle qui doit être étendu (au delà des grandes entreprises), diversifié (simultanément ou alternativement au travail salarié) et appuyé sur un revenu minimum, de l’ordre du SMIC. Ce faisant il s’agit ni plus ni moins que de conférer un « droit à l’activité » pour tous, négocié contre une flexibilité assumée mais débarrassée de son caractère profondément inégalitaire (en s’inspirant de la flexisécurité).
Pour que l’associationnisme puisse porter ces promesses, encore faut-il qu’une véritable politique de l’association se mette en place, c’est à dire « la capacité du mouvement associatif à se constituer en un acteur politique disposant de suffisamment d’unité, d’autonomie et de volonté pour se fixer un agenda politique et une fonction institutionnelle en rapport avec son poids réel dans la société ». Politique que l’auteur entend asseoir autour de quatre axes :
- Le volontariat généralisé (à la différence du bénévolat qu’il complète, il fait l’objet d’une rétribution minimale), qui génère une nouvelle catégorie d’activités au delà de l’État et du marché et qui doit être encouragé par des dispositifs légaux et financiers, dont l’auteur liste les modes de financements possibles.
- La mise en place d’un livret de compétences qui permette de reconnaître les compétences transverses, notamment celles acquises hors du système scolaire et universitaire. Ceci consacrerait un changement de posture de l’école, devenant « espace de réflexivité de savoirs majoritairement produits à sa périphérie », à l’image de ce qui se pratique en Finlande.
- L’affirmation de l’indépendance du secteur associatif, qui ne peut et ne doit être ni supplétif du service public ni prestataire de services. Ceci passe par une réforme des institutions représentatives du monde associatif (Haut conseil à la vie associative, CPCA - Conférence Permanente des Coordinations Associatives...) sur la base de mode de désignation par élections ascendantes, de mandats à durée limitée et de dotation en ressources autonomes. Le passage d’un statut purement consultatif à une intervention dans le processus législatif pour le Conseil économique, social et environnemental, serait également essentiel.
Au final, Roger Sue invite la gauche à s’emparer de l’associationnisme comme levier majeur d’un renouvellement démocratique participatif, d’un dépassement des contradictions entre travail aliénant et travail émancipateur, entre individu et collectif, et des postures purement critiques, sans perspective d’alternatives. Il y voit également une contribution à l’émergence des « communs », de leur passage à l’échelle, impliquant un public toujours plus large.
Commentaires
La première vertu de ce texte est certainement d’allier à l’audace conceptuelle des perspectives concrètes de transformation des relations entre connaissances, travail, temps et engagement. L’ouvrage montre comment notre société porte en elle, à travers la richesse et la diversité du monde associatif, les germes de ce qui pourrait être la « grande transformation » de demain. Ce monde associatif est aujourd’hui en situation ambiguë : négligé par les instances politiques, considéré comme une sorte de « supplément d’âme » qui vient arrondir les angles d’une société livrée à l’économie de marché, il tend à se complaire dans une forme de marginalité. Entre opposition – pour les mouvements de résistances –, réparation – pour les associations de solidarité – ou substitution – pour les associations assumant des missions de service public –, il n’ose assumer l’ambition à laquelle l’invite Roger Sue : celle d’une alternative au marché et à l’État, capable d’accompagner structurellement nos sociétés dans leur entrée dans les sociétés de connaissances.
Cette perspective est particulièrement stimulante pour tous ceux qui œuvrent à la construction des « communs » (voir Libres savoirs, ouvrage coordonné par Vecam, 2011, C&F Éditions) comme cela n’a pas échappé à l’auteur.
Le monde associatif, et plus généralement l’économie sociale et solidaire, apparaît comme le maillon indispensable entre deux approches : celle du « bien commun » et celle des « biens communs ». Le passage du singulier au pluriel (ou l’inverse) n’est pas trivial. Le bien commun peut être envisagé comme une version élargie de l’intérêt général, renvoyant moins au fruit d’un contrat social, qu’aux valeurs que l’humanité se doit de partager (en son sein mais aussi dans son rapport à la nature), dans un souci à la fois de préservation et de développement. Si les biens communs embrassent également ce double objectif de préservation et de renouvellement créatif, ils s’ancrent non pas dans des valeurs abstraites et universelles mais dans la construction très opérationnelle de règles de gouvernance appliquées à une ressource clairement identifiée, matériel ou immatérielle, locale ou non (une forêt ou un logiciel). En ce sens la pensée des « biens communs » présente une double essence politique et économique, qui constitue à la fois sa force – en pensant d’entrée de jeu l’économique hors de la sphère marchande – et sa faiblesse – en ne pouvant pas s’appliquer aux champs de l’activité humaine qui échappent (ou devraient échapper) totalement à l’économique (comme la biodiversité ou la justice).
Le monde associatif possède de fait un pied dans chacune de ces deux approches : en poursuivant des objectifs non lucratifs, en répondant à des besoins que le marché par essence ne couvre pas et que la puissance publique néglige, en ouvrant des espaces de développement personnel ignorés du marché comme de l’État, l’association participe à l’évidence du « bien commun ». En inventant les règles de gouvernance indispensables à la poursuite d’activités non marchandes, les associations contribuent à créer de nouvelles communautés de « biens communs ». Si les biens communs englobent une diversité de communautés qui dépassent largement le monde associatif (communautés d’habitants, réseaux informels, communautés de développeurs, riverains d’une rivière...), ce dernier n’en constitue pas moins une composante de taille.
L’association, dégagée des contraintes de la valeur d’échange et de la profitabilité (ce qui ne la dédouane pas d’obligations d’efficacité), participe au renouvellement de la conception même de la valeur – valeur des connaissances, valeur du travail comme l’évoque Roger Sue - mais aussi valeur des biens, des services produits, des sociabilités tissées, de la justice sociale réinjectée, de la créativité suscitée... Où l’on retrouve le lien entre les « biens communs » comme manière de revisiter les fondamentaux de l’économie et le « bien commun » comme horizon de sens et de mesure du bénéfice collectif.
On notera toutefois que le livre, sur son versant économique, souffre des mêmes faiblesses que l’état de la pensée actuelle sur les communs : l’articulation entre les trois sphères – sphère publique, sphère marchande, sphère associative/des biens communs – et la circulation des ressources comme des contributions entre ces trois secteurs reste à définir, même si l’auteur s’efforce d’ouvrir des pistes fécondes. C’est certainement un terrain de forte conflictualité entre ceux qui tentent d’inventer une troisième voie, au delà du marché et du secteur public : quelles doivent êtres les contributions de ces derniers au financement du secteur associatif, et à quelles conditions susceptibles de justifier cette contribution tout en préservant l’autonomie de celui-ci ? Les communs doivent-ils être soumis à une forme de taxation de la richesse non marchande créée, afin de contribuer à la sphère publique en retour ? Quelle peut/ doit être la part des échanges non monétarisés (ou appuyés sur des monnaies alternatives) à l’intérieur du secteur des biens communs ? Quels sont les vecteurs de la reconnaissance dans le cadre d’échanges gratuits ou de dons/contre dons ? Autant de questions et bien d’autres qui attendent encore notre inventivité économique et politique.
Enfin on pourra reprocher au livre une forme d’angélisme dans sa description du monde associatif : celui-ci apparaît dénué de tout rapport de force interne, de toute difficulté en tant qu’espace de socialisation. Certes le monde associatif est un espace de « construction de soi », de valorisation, de reconnaissance. Mais il peut aussi se révéler espace de concurrence, de conflictualité, voire d’une certaine forme de violence : la construction d’un sens commun fait appel à une implication émotionnelle voire affective de l’individu, qui peut parfois transformer l’expérience associative en source de dépréciation de soi. S’il n’y a pas dans le monde associatif de lien du sujétion au sens où on l’entend dans le monde du travail, il n’échappe cependant pas à la question du pouvoir et de sa régulation.
Cette critique n’est qu’une invitation pour le monde associatif à poursuivre l’exploration de nouvelles gouvernances susceptibles de laisser éclore le potentiel créatif et contributif de chaque participant tout en le protégeant des enjeux de pouvoir.