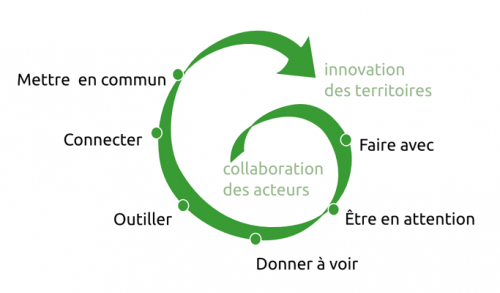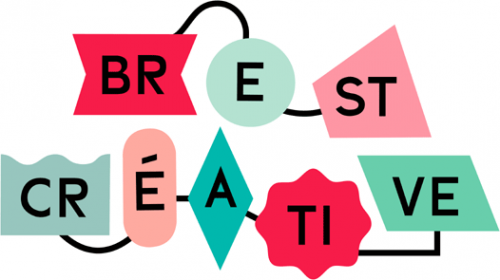C’est un coup de théâtre qui m’a laissé speechless : le parlement européen envisage sérieusement de mettre fin au droit des bases de données. C’est la 108e recommandation d’une motion adressée à la Commission Européenne sous le titre « Vers un Marché digital unifié » (et relayée par une excellente synthèse de Julia Reda). Elle tient en une ligne :
108. Le parlement Européen note que l’évaluation par la Commission Européenne de la directive sur le droit des bases de données conclut que ce dispositif nuit au développement d’une économie de la donnée (« data-driven ») européenne ; il appelle la commission à en tirer les conséquences qui s’impose en supprimant la directive 96/9/EC.
En 1996, la directive européenne 96/9/EC ajoute un nouveau chapitre au code de la propriété intellectuelle. Elle prévoit un droit « sui generis » pour les producteurs des bases de données : ceux-ci peuvent empêcher toute réutilisation « substantielle » de la base :
Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
En pratique, le droit des bases de données s’est imposé comme, de loin, l’un des droits les plus « généreux » pour son titulaire (et, par réciprocité, le plus restrictif pour l’utilisateur et le public). En effet :
- Il n’est pas borné par un critère clair : toutes les bases de données sont concernées dès lors que son détenteur investit pour les maintenir. Par contraste, le droit d’auteur ne porte que sur des productions originelles (ce qui fait que l’on ne peut réclamer, à ce titre, une protection pour des idées, des données élémentaires pour des expressions non significatives) ; le droit des marques ne s’applique que dans le champ commercial où une entreprise est active.
- La notion d’usage substantiel n’est pas définie. Le législateur européen permet de l’évaluer de « façon qualitative ou quantitative » ; tout en visant avant tout la base de donnée dans son entièreté, il laisse la porte ouverte à une appréciation beaucoup plus restrictive (par exemple, toute reprise qui porte la « marque » de la base d’origine). En France, la jurisprudence retient de plus en plus une interprétation maximaliste (à l’image du procès Notre Famille).
- Le droit est potentiellement éternel. La durée de protection de 15 ans ne part en effet que du moment où le producteur de la base cesse de l’entretenir. Tant qu’il continuer d’apporter des modifications il peut repousser la date d’expiration : « Toute modification substantielle (…) permet d’attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre. »
- Dans un environnement numérique, le droit est « contaminant ». Sur Internet, tout est donnée : un livre est un ensemble de données textuelles ; une œuvre musicale un ensemble de données sonores. C’est ainsi que dans le cadre du projet Notre Famille, les archivistes ont pu revendiquer un droit « sui generis » sur des documents administratifs du XVIIe ou du XVIIIe siècle. À ce titre, le droit des bases de données constitue un argument juridique privilégié pour défendre un copyfraud, soit l’application de droits indus sur une production entrée dans le domaine public.
On le voit, le droit des bases de données génère des insécurités juridiques majeures pour de nombreux usages. C’est à ce titre que la fouille de texte et de données a pu être dissociée du « droit de lire ». C’est à ce titre que les institutions publiques ou privées peuvent justifier l’adjonction de copyfraud. C’est à ce titre que les licences libres ont dû être amplement reformulées (à l’image de la version 4.0 de Creative Commons) pour éviter d’ajouter des restrictions indues contraires à leur intention initiale. C’est à ce titre, finalement, que la circulation des informations est largement bloquée dans notre société. Il est ainsi impossible, en l’état, de reprendre de nombreuses séries d’informations a priori brutes sur Wikipédia, sur WIkidata ou sur des plate-formes d’open data, sans encourir un procès potentiel.
Cet obstacle considérable reste cependant récent : il a été codifié il y a moins de vingt ans ; il figure de manière récurrente dans la jurisprudence depuis moins longtemps encore. Le droit n’a pas été suffisamment naturalisé dans notre législation pour rester indéracinable. En l’état, la mention du droit « sui generis » dans le code de la propriété littéraire et artistique fait figure d’anomalie : alors que tout le reste du code s’adresse à des « auteurs » on parle ici de « producteurs » ; alors que le critère d’originalité est un soubassement récurrent, il est totalement évacué.
Néanmoins la suppression du droit des bases de données n’est pas une certitude à ce stade. En dépit du soutien affiché du parlement européen, les oppositions risquent d’être considérables : les GAFAs ont très largement profité de ce cadre légal bien plus généreux que son équivalent américain (qui ne reconnaît qu’un droit à la compilation). On risque d’assister à l’émergence d’un front commun entre industries culturelles et industries du web (ce qui aurait au moins pour effet de clarifier les clivages…).
Par ailleurs, Lionel Maurel m’a signalé que l’abolition de la directive 96/9/EC ne suffira peut-être pas pour lever toutes les restrictions. Depuis l’affaire Ryanair, la jurisprudence européenne a consacré la supériorité des Conditions Générales d’Utilisations contractuelles sur le droit législatif : une entreprise ou une institution n’a même pas besoin d’invoquer le droit des bases de données pour empêcher des reprises, même limitées, de sa base. La Cour Européenne de Justice « a écarté l’application de cette exception pour considérer que les CGU de la base pouvaient valablement interdire l’exercice des droits reconnus par la directive aux utilisateurs légitimes d’une base de données. »
Au-delà du fondement légal, je pense que la présence du droit des bases de données consacre un certain état d’esprit « hyper-propriétaire », marqué par une extension toujours plus maximaliste des droits de propriétés sur les créations intellectuelles. Sa disparition aurait pour effet de refermer une parenthèse d’une vingtaine d’années en montrant que l’extension propriétaire n’est pas inéluctable et que les institutions politiques peuvent revenir sur les droits accordés s’ils nuisent à la société au sens large.